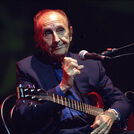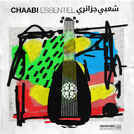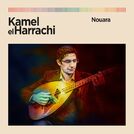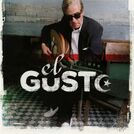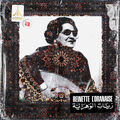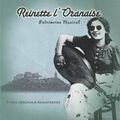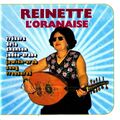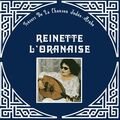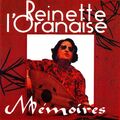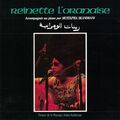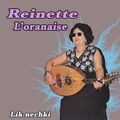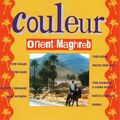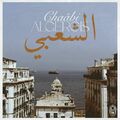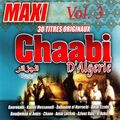Reinette L'oranaise
924 fans
Née à Tiaret dans l'Ouest algérien en 1915, Sultana Daoud est la fille d'un rabbin d'origine marocaine et d'une mère juive d'Algérie. Atteinte de cécité dans son enfance, elle fréquente une école pour aveugles à Alger où elle apprend le braille et le cannage des chaises. Sa mère préfère la confier à Saoud Medioni, l'un des chanteurs les plus en vue de l'époque, pour être initiée aux subtilités du style arabo-andalou. Elle y gagne son surnom de Reinette l'Oranaise et un enseignement de la darbouka, de l'oud, et de la mandole. Reinette l'Oranaise suit Saoud Medioni à Paris en 1938, mais doit s'enfuir après la déportation de son mentor par les nazis en 1943.
Revenue à Alger alors capitale de la France libre, Reinette l'Oranaise voit sa cote de popularité monter au rythme des passages de ses chansons sur Radio Alger. Elle devient alors le pendant féminin de Cheikh Raymond, et l'une des plus grandes interprètes féminines du chââbi et du hawzi. Reinette l'Oranaise comme Lili Boniche à la même époque, excelle aussi bien dans un répertoire populaire de variétés orientales que dans les formes plus savantes de la chanson judéo-arabe, cousine directe de l'arabo-andalou. Sa période de gloire est de courte durée, très vite perturbée par la guerre d'indépendance algérienne. Comme la majorité des cent et quelque mille juifs d'Algérie, Reinette l'Oranaise préfère en 1962 l'exil en France plutôt que l'incertitude d'une Algérie où les communautés viennent de se déchirer.
Reinette l'Oranaise connaît alors la solitude, et ne remonte tardivement sur scène qu'en 1985. Elle se produit enfin à L'Olympia ou au Bataclan ainsi qu'à l'étranger. Reinette l'Oranaise est faite Commandeur des Arts et des Lettres en 1989, et reçoit le Prix Charles Cros pour l'enregistrement tardif des cinq titres de Mémoires en 1995. Reinette l'Oranaise dit un adieu définitif à son public le 17 novembre 1998 suite à un arrêt cardiaque. Ne reste de son art que le film Reinette l'Oranaise, le port des amours (1991) sorti en DVD en 2009, quelques 78 tours épars, et les compilations Trésor de la Chanson Judéo-Arabe (2006) et Patrimoine Musical (2012).
Revenue à Alger alors capitale de la France libre, Reinette l'Oranaise voit sa cote de popularité monter au rythme des passages de ses chansons sur Radio Alger. Elle devient alors le pendant féminin de Cheikh Raymond, et l'une des plus grandes interprètes féminines du chââbi et du hawzi. Reinette l'Oranaise comme Lili Boniche à la même époque, excelle aussi bien dans un répertoire populaire de variétés orientales que dans les formes plus savantes de la chanson judéo-arabe, cousine directe de l'arabo-andalou. Sa période de gloire est de courte durée, très vite perturbée par la guerre d'indépendance algérienne. Comme la majorité des cent et quelque mille juifs d'Algérie, Reinette l'Oranaise préfère en 1962 l'exil en France plutôt que l'incertitude d'une Algérie où les communautés viennent de se déchirer.
Reinette l'Oranaise connaît alors la solitude, et ne remonte tardivement sur scène qu'en 1985. Elle se produit enfin à L'Olympia ou au Bataclan ainsi qu'à l'étranger. Reinette l'Oranaise est faite Commandeur des Arts et des Lettres en 1989, et reçoit le Prix Charles Cros pour l'enregistrement tardif des cinq titres de Mémoires en 1995. Reinette l'Oranaise dit un adieu définitif à son public le 17 novembre 1998 suite à un arrêt cardiaque. Ne reste de son art que le film Reinette l'Oranaise, le port des amours (1991) sorti en DVD en 2009, quelques 78 tours épars, et les compilations Trésor de la Chanson Judéo-Arabe (2006) et Patrimoine Musical (2012).
Top titres
Playlists
Artistes similaires
Albums
| Reinette l'Oranaise |
| Patrimoine musical |
|
Trésors de la chanson Judéo-Arabe, Reinette l'Oranaise
|
|
Trésors de la chanson judéo-arabe
|
|
Trésors de la chanson Judéo-Arabe, Reinette l'Oranaise
|
|
Reinette l'Oranaise, Mémoires
|
|
Mémoires
|
|
L'Olympia 1989 (Live à l'Olympia 1989)
|
|
Trésors de la musique arabo-andalouse
|
Singles
|
Lik nechki
|
Apparaît dans
|
Chansons d'exils d'Afrique du Nord (2014 Remastered)
|
|
Couleur Orient - Maghreb
|
| Algeria |
| Chaabi Algérois |
| Maxi Chaabi d'Algérie, Vol. 3 |